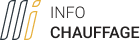Le stockage thermique n’est plus de la science-fiction, mais une solution concrète déjà adoptée par des milliers de foyers en Europe. Le Danemark fait figure de pionnier avec plus de 2 500 installations de stockage intersaisonnier de chaleur (STES). Le principe est aussi simple qu’efficace : capter la chaleur de l’été, la conserver dans le sous-sol et la réutiliser pour se chauffer durant l’hiver.
Le principe est à la fois simple et ingénieux. Grâce à différentes technologies de stockage thermique par chaleur sensible ou stockage thermique par chaleur latente, ces systèmes captent et conservent l’énergie thermique lorsqu’elle est abondante. Les rendements sont particulièrement impressionnants, avec un rapport entre la chaleur utilisée et la chaleur stockée supérieur à 50%. Certaines installations peuvent même atteindre des dimensions considérables – la fosse principale de certains systèmes peut mesurer dans sa partie supérieure 88 m sur 113 m, soit la surface d’un terrain de football.
Ainsi, favoriser la géothermie avec du stockage à recharge active pourrait considérablement contribuer à l’atteinte de la cible officielle de 100 TWh de chaleur fournie par la géothermie autour de 2040. Cette recharge peut provenir de diverses sources comme les panneaux solaires thermiques, la chaleur fatale industrielle ou encore les eaux usées. Dans cet article, vous découvrirez comment ces systèmes de chaleur thermique, déjà éprouvés sur certains réseaux comme ceux de Marstal ou Dronninglund au Danemark, peuvent être adaptés à votre maison individuelle.
Typologie des systèmes STES adaptés à la maison individuelle

Plusieurs technologies de stockage thermique intersaisonnier peuvent être adaptées à l’échelle d’une maison individuelle. Ces systèmes se distinguent principalement par leur méthode de stockage et les matériaux utilisés.
Le stockage en aquifère (ATES) utilise les nappes phréatiques comme médium. Ce système nécessite deux puits ou plus pour injecter et extraire l’eau chauffée. Malgré son faible coût et sa grande capacité de stockage, l’ATES requiert des conditions géologiques spécifiques rarement réunies dans les zones résidentielles.
Plus répandu pour les maisons individuelles, le stockage en champ de sondes (BTES) consiste en un ensemble de sondes géothermiques verticales de 30 à 100 mètres de profondeur. Cette solution offre une bonne modularité et nécessite peu d’espace en surface, ce qui la rend idéale pour les zones résidentielles.
Le stockage en fosse (PTES) et en réservoir (TTES) représentent également des options viables. Le PTES utilise une fosse semi-enterrée remplie d’eau ou d’un mélange d’eau et de gravier, tandis que le TTES emploie un réservoir souterrain mieux isolé.
Par ailleurs, les systèmes utilisant des matériaux à changement de phase (MCP) offrent une densité énergétique jusqu’à trois fois supérieure aux solutions traditionnelles. Ces matériaux absorbent ou libèrent de l’énergie lors du changement d’état, permettant un stockage compact particulièrement adapté aux contraintes spatiales des maisons individuelles.
Le choix du système dépend essentiellement des caractéristiques géologiques du terrain, de l’espace disponible et des besoins thermiques du foyer.
Exemples de projets STES résidentiels en Europe et au Canada
En Europe et au Canada, plusieurs projets résidentiels démontrent l’efficacité du stockage thermique intersaisonnier à différentes échelles.
L’exemple emblématique de Drake Landing au Canada illustre parfaitement cette technologie. Cette communauté de 52 maisons individuelles utilise 800 collecteurs solaires installés sur les toits des garages. Grâce à un système BTES composé de 144 puits profonds creusés à plus de 37 mètres sous la surface, cette installation atteint des performances exceptionnelles : 97% des besoins de chauffage ont été couverts par l’énergie solaire en 2012, un record mondial pour une installation de cette taille. Toutefois, après près de 17 ans d’exploitation, le système a commencé à être démantelé en 2024.
Au Danemark, la ville de Marstal abrite l’une des plus importantes centrales de chauffage solaire, avec 33 000 m² de panneaux et un stockage de 75 000 m³. Ce système alimente environ 1 500 logements. Vojens détient quant à elle le plus grand réservoir thermique en fosse au monde, d’une capacité de 203 000 m³.
En Allemagne, l’installation de Rostock utilise depuis 2000 un stockage en aquifère (ATES) pour un immeuble de 108 appartements. Ce système a atteint son objectif avec 49% des besoins couverts par l’énergie solaire.
Enfin, la France a inauguré en 2021 son premier projet résidentiel à Cadaujac (Gironde). Ce système combine 950 m² de panneaux solaires thermiques avec 60 forages de 30 mètres de profondeur, permettant aux 67 logements de l’écoquartier « Domaine du Moulin » de couvrir 80% de leurs besoins en chauffage et eau chaude.
Contraintes, coûts et conditions de mise en œuvre en maison individuelle

L’installation d’un système STES en maison individuelle présente des défis techniques et économiques spécifiques. Les rendements de ces systèmes sont généralement satisfaisants, avec un rapport entre la chaleur utilisée et stockée supérieur à 50%. Toutefois, les coûts d’installation peuvent être élevés, ce qui tend à réserver ces techniques aux nouvelles constructions.
Pour les systèmes BTES, l’espacement entre les sondes géothermiques varie de 3 à 8 mètres, avec des profondeurs allant de 50 à 300 mètres. Ces installations n’empêchent généralement pas l’utilisation du sol en surface et peuvent exister sous les bâtiments ou les parcs de stationnement.
Par ailleurs, la réglementation RE 2020 impose de nouvelles contraintes pour les constructions neuves, avec un surcoût d’environ 3,4% sur les prix des futures constructions. Pour une maison de 90 m², le prix moyen serait aujourd’hui de 2 025 €/m² contre 1 959 €/m² avant cette réglementation.
En matière de géothermie, les installations considérées comme relevant du régime de minime importance doivent respecter des critères spécifiques : profondeur inférieure à 200 mètres, puissance thermique maximale de 500 kW, et température du fluide caloporteur entre -3°C et 40°C. La réalisation doit être effectuée par un foreur certifié Qualit’EnR.
Enfin, les solutions de stockage thermique intersaisonnier sont encore peu appliquées en France en raison d’un manque de connaissance du grand public et d’absence de cadre réglementaire adapté.
Conclusion
Le stockage thermique intersaisonnier représente donc une solution d’avenir pour les maisons individuelles, malgré certaines contraintes techniques et économiques. Ces systèmes, qu’il s’agisse de stockage en aquifère (ATES), en champ de sondes (BTES), en fosse (PTES) ou en réservoir (TTES), offrent des rendements impressionnants dépassant souvent 50%.
Certes, les exemples comme Drake Landing au Canada ou les installations danoises de Marstal et Vojens démontrent la viabilité de cette technologie à grande échelle. Ces projets pionniers prouvent sans aucun doute que le stockage thermique peut couvrir jusqu’à 97% des besoins de chauffage des habitations.
Cependant, l’adaptation à l’échelle d’une maison individuelle française reste un défi. Les coûts d’installation relativement élevés limitent actuellement l’accessibilité de cette technologie, particulièrement pour les bâtiments existants. La réglementation RE 2020 et les contraintes liées aux installations géothermiques nécessitent également votre attention lors de la planification d’un tel projet.
Parallèlement, le faible niveau de connaissance du grand public et l’absence d’un cadre réglementaire adapté freinent le développement de ces solutions en France. Pourtant, leur potentiel demeure considérable, surtout lorsque vous les associez à d’autres sources d’énergie renouvelable comme les panneaux solaires thermiques.
À l’avenir, l’évolution des technologies de stockage, notamment celles utilisant des matériaux à changement de phase, pourrait réduire les contraintes spatiales et rendre ces systèmes plus accessibles aux propriétaires de maisons individuelles. Le développement de nouvelles politiques de soutien financier et technique faciliterait également leur adoption.
Cette technologie prometteuse pourrait ainsi contribuer significativement à la transition énergétique des logements français, tout en vous offrant une solution durable pour réduire votre dépendance aux énergies fossiles et diminuer vos factures énergétiques à long terme.